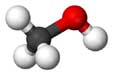La politique de la transition énergétique est essentiellement celle de la décarbonation de toutes les formes de production d'énergie. La production de chaleur compte pour 44% de la production d'énergie primaire en France (1, 1m34), tandis que le chauffage (eau chaude comprise) consomme en énergie l'équivalent d'environ 80% de la production électrique (2). On parle prioritairement, en France, dans les médias de la nature du mix électrique, alors qu'il est à 95% décarboné (chiffre de 2024) (2g) et qu'il représentait, en 2023, 27% de la production d'énergie (2a), tandis sur les 1420 Twh d'énergie produite, la production de chaleur représentait, en 2023, 625 twh, c'est à dire 44% =(173,5/0,278)=625/1420 (2b)(2c) (2d).
La production de chaleur pour l'industrie
L'industrie consomme 110Tw/an, c'est à dire 10/625=17,6% de la chaleur produite (2f).
La France a décidé, dans le cadre du projet France 2030, de consacrer 5 Milliards d'Euros d'ici 2030 pour aider à la décarbonation de 50 sites sites industriels qui représentent 60% des émissions dans le domaine industriel (2h). Ce budget parait toutefois faible en comparaison des investissements nécessaires. Cette politique est basée sur 4 procédés:
-l'électrification des procédés
-la capture et le stockage du CO2
-la production d'hydrogène vert
-la biomasse
-> Pour la biomasse, on ne peut pas en réalité la qualifier comme un procédé complétement décarboné, puisque 'est plutôt la capture du carbone, qui si elle est associée à la biomasse, peut constituer un procédé décarboné. L'intensité carbone moyenne de la biomasse, sans capture de C02 est en effet en moyenne de 75gCO2/kwh (2i), c'est à dire 5 fois moins que le méthane qui est à 352g/kwh(2k), mais par exemple 3 fois plus que le biométhane 25gCO2/kwh (2j). De plus le bilan carbone de la biomasse peut être très variable suivant les conditions d'utilisation (reboisement..), puisque l'intensité carbone du bois de chauffage est par exemple de 356g/kwh (2k).
->La capture du CO2 repose sur des précédés éprouvés dont la mise en œuvre repose essentiellement sur le surcout induit, et de son financement par le niveau de taxe carbone appliqué. Il y a ensuite deux alternatives:
-soit la réutilisation (CCUS) du carbone, par exemple vers du méthane ou du méthanol (p32/26). Quelques projets seulement sont en cours dont celui de Lacq (2o). La rentabilité du e-methanol ,par exemple, reste toutefois, en 2025, conditionnée par le niveau et les modalités de taxe carbone appliquée aux énergies fossiles concurrentes.
-soit le stockage souterrain (CCS). C'est essentiellement cette voie qui serait envisagée par le projet gouvernemental (p30/40) en particulier avec l'étude EvastoCo2, destinée à évaluer les sites potentiels de stockage en France (2l). Cette étude a recensé des sites, par exemple dans las bassins parisien et aquitain (2m), mais qui paraissent toutefois très éloignés des sites industriels d'émissions de C02 (p21/36).
->La production d'hydrogène vert est un procédé qui peut sembler séduisant en théorie. La France envisage essentiellement la production d'hydrogène vert comme un moyen de décarbonation des sites industriels (p22/30), en application des orientations européennes. Sa rentabilité pose toutefois question. En effet, comme souligné dans d'autres articles de ce site, si l'hydrogène vert peut être envisagé en particulier comme solution d'utilisation des Enri, le seuil de rentabilité n'existe pas encore (p14/26). De plus les Enri n'étant disponibles en moyenne que 20% du temps, il n'est pas possible de fixer une prévision de coût à partir des Enri alors qu'en France 50-80% du temps (suivant les périodes d'utilisation) c'est le cout de l'électricité nucléaire qui doit être pris comme base calcul du coût de l'électricité. Le stockage de l'hydrogène est en effet onéreux pour des quantités importantes, ce qui rend son utilisation immédiate quasi nécessaire. A défaut il est probablement plus rentable de produire de l'ammoniac, qui d'après l'Aiea représenterait, en 2030, 50% des débouchés de production de l'hydrogène vert (p96/176). Il parait donc peu probable que le coût de l'hydrogène vert puisse baisser sensiblement en dessous de 150Eur/Mwh (p8/11)(2s), même par un effet d'échelle, d'autant qu'il est par exemple en concurrence avec l'hydrogène turquoise, obtenu par pyrolyse du méthane, dont le cout de production est en 2025 plus de deux fois plus faible (2n). Le bilan carbone de l'hydrogène turquoise est cependant plus significatif que celui du méthane vert à 0,91gCo2/kg d'H2 (2p) contre moins de la moitié pour le vert, mais 10 fois moins élevé que l'hydrogène obtenu par vapo-réformage du méthane (hydrogène gris). Avec 57% des importations Françaises de méthane en 2024 qui venaient du Gnl (2q), dont 30% des gaz de schiste (2r), le bilan carbone complet de l'hydrogène turquoise serait cependant supérieur à 0,91gCo2/kg d'H2, à cause des émissions de méthane des gaz de schiste, qui représentent environ 17% de la consommation (17%=0,3*57%). Néanmoins, il faut rappeler que pour produire 122twh d'hydrogène vert, destiné à remplacer 110twh de chaleur (rendement de 90%), il faudrait consommer environ 190twh d'électricité (2o) ce qui représenterait environ 35% de la production d'électricité, de 2024. Ceci montre que l'hydrogène vert ne peut pas être envisagé comme seul moyen de décarbonation de la chaleur destinée à l'industrie.
->l'électrification des procédés selon une étude de la Fabrique de l'industrie (p3/4): "reste tributaire d’une électricité décarbonée mais également disponible en quantité abondante et à des prix compétitifs et prévisibles".
Le chauffage
Le chauffage résidentiel qui représentait en France, en 2019, 440Twh, soit environ 70% de la production de chaleur, et 440/1420 30% de l'énergie totale, est assuré à 60% par des énergies carbonées (gaz,fioul, bois) (2e). En France, en 2023, prés de 60% de la consommation de gaz est utilisée par le chauffage (p2/12)(2p). Si l'électricité en France est à 95% décarbonée (chiffre de 2024) (2g), la politique de la transition doit par exemple plutôt porter ses efforts sur la décarbonation du chauffage.
L'exemple de la Suède est un modèle à suivre pour l'union européenne (3). En effet le chauffage n'émet quasiment pas de CO2 contrairement aux autres pays (4, 15min02). Or ce très faible bilan carbone vient davantage du mode de chauffage: réseaux de chaleur (5) (pour 60%) et bois (21%) (6, 14min58) que de l'isolation. Les réseaux de chaleur en France sont par Kwh moins émetteurs que le chauffage d'origine électrique (7). De plus les chaudières des réseaux sont par principe beaucoup moins émettrices que les individuelles ou de copropriété, car on peut associer beaucoup plus facilement aux premières la pyrolyse (gaz, bois..)(7a) ou la capture du carbone, même si un nombre encore important était alimenté en 2019 par des énergies fossiles (p12).
Cependant, en 2017, la part du chauffage par réseaux de chaleur était de 5% en France, contre 47% en Suède, et 60% au Danemark (8) (p17/74) alors qu'il y a des sources de développement très importantes dans les grandes agglomérations comme Paris (9, p86/154) qui bénéficie aussi d'un potentiel de géothermie important. Une étude montre que pour les habitats collectifs et tertiaires, les réseaux de chaleur sont le mode de chauffage le moins cher (10), tandis que la France est parmi les moins avancés en Europe (p12/52) et parmi les moins engagés à l'horizon 2030 (p31/52) alors que l'interdiction des chaudières alimentées par des fossiles est déjà prévue au niveau européen en 2040 (11). Dans des chaudières plus importantes, couplées à des réseaux de chaleur on peut par exemple développer des chaudières à hydrogène (12) alimentées par exemple par pyrolyse du méthane, ou plus simplement capter le CO2 issu de la combustion du gaz.
Les méthodes de stockage de la chaleur avec du sable (13) (15) permettent aussi de combiner les Enr intermittentes avec les réseaux de chaleur. Le solaire thermique (22min) qui a un rendement proche de 80%, à comparer au 30% maximum du solaire photovoltaïque, parait être une utilisation possible de ces derniers modes de stockage (16) (2min).
Il est beaucoup plus long et coûteux d'amortir, sur une durée souvent voisine de 30 ans (26) (27, p8), une rénovation thermique que de changer son mode de chauffage (28). La majorité des rénovations énergétiques pour un classement DPE, vers les étiquettes A,B,C ne sont en effet pas amorties sur une durée de 20 ans. Une étude montre par ailleurs qu'il est peu rentable de superposer le raccordement à un réseau de chaleur et la rénovation thermique des bâtiments, en particulier en zone urbaine dense (p 19/28).
En 2023, la dotation annuelle de 0,52 milliard du fonds chaleur (17, p185), paraît nettement insuffisante au regard d'une politique de la transition cohérente. Pour le région Ile-de-France, où 7 millions d’équivalents-logements ne sont pas raccordés (18), leur raccordement s'élèverait à 7/37*69=13 milliards d'Euros, qui pourrait venir en remplacement d'un réseau de gaz par ailleurs vétuste (19), alors que la nappe géothermique du bassin parisien est l'une des meilleures de France (20).
La région Ile de France (et en particulier le Grand-Paris (21)) est celle où les réseaux de Chaleur sont les plus vite rentabilisés (22, p47), d'autant que ceux ci peuvent être associés à la géothermie. Il y en moyenne dans les agglomérations Françaises, une grande différence entre les zones à fort potentiel de développement des réseaux de chaleur (23) et l'état de leur développement en 2024 (24). A titre de comparaison la place envisagée dans les réseaux de chaleur dans les mix énergétiques des scenarios de l'Ademe (25, p20/23) paraît peu réaliste.
En Île-de-France, en 2012, trop peu de RCU existants étaient alimentés (p5/31) par la géothermie, ou étaient associés à la capture du carbone (p26), surtout dans le Nord et à l'Ouest de la région (p24). Il est plus rentable à court terme (rapport niveau des investissements/ niveau de décarbonation obtenu) de commencer par définir un plan de migration des réseaux déjà existants vers la géothermie/biomasse (24a) (24b) plutôt que de construire de nouveaux réseaux, ce qui implique des délais de mise en exploitation et des coûts plus importants (il faut construire le réseau de distribution en plus). Cette règle de "rentabilité au plus tôt", ou de réalisation au plus pressé des objectifs de décarbonation, n'est toutefois pas compatible avec le financement actuel des réseaux de chaleur qui se fait au niveau communal ou intercommunal, alors que prioriser les financements vers les réseaux existants impliquerait plutôt une gestion au niveau régional. La norme RE2020 impose par ailleurs d'ici 2028 des maxima d'émissions pour les réseaux existants (p35/74), ce qui obligera au minimum de migrer vers une alimentation avec des solutions hybrides, si le gaz est conservé (25d) (25e). Cette dernière solution correspond d'ailleurs à une solution plus efficace d'utilisation de l'électricité pour la diminution des émissions de CO2 que la voie d'électrification des transports (16min30). Le Pcaet de Paris à l'horizon 2030 (p19/183) , ne prévoit paradoxalement pas de réduction chiffrée de la part de l'alimentation en gaz de la ville dans son mix énergétique, mais plutôt d'augmenter la part des Enr à partir d'une baisse globale de la consommation qui serait basée sur une augmentation de l'isolation (76/183). On a toutefois dans ce plan un objectif annoncé à l'horizon 2040 (p103) de "sortie du gaz pour les équipement municipaux, via les RC", alors qu'en pratique ce dernier objectif ne peut être dissocié d'une suppression de l'alimentation en gaz des réseaux de chaleur de la ville. En effet, les équipements municipaux sont répartis de façon homogène sur l'ensemble des réseaux de la ville. A Paris par exemple, 50% des RC seulement utilisent des Enr ou de récupération(25a); 0,2% la géothermie et 47% le gaz naturel.
L'ile de France concentre par ailleurs 37%(=9,7/26,3) de la production des RC, tandis qu'en 2023, 33% étaient encore alimentés par le gaz (25b)(25c). La cour des comptes a jugé en 2023 les objectifs de décarbonation de la ville de Paris incompatibles avec ceux du grand Paris (p63).
Un exemple territorial de RC, dans les Hauts de Seine.
Les Hauts de Seine, sont le département avec le potentiel le plus important de développement après Paris (26).
Tandis que le Cerema préconise de faire appel pour le développement d'un nouveau RCU à l'intercommunalité, le Gpso (Établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest) prévoit de développer largement la géothermie à l'horizon 2050, comme source d'énergie décarbonée (p14,16/38): celle-ci passerait de 8% à 44% du mix énergétique. Cette orientation est décrite dans le Plan climat-air-énergie territorial, 2019-2025, de Gpso. A l'horizon 2030, il y aurait en particulier le projet de multiplier par 3 la production d'énergie de source géothermique (p17/38), avec 164Gwh/an de production additionnelle. En comparaison, la biomasse est une source d'énergie assez limitée, les sources existantes par exemple ne dépassant pas une production supérieure à 2Gwh/an (27).
Pour mener à bien cet objectif, il a été décidé le développement d'un RC commun aux communes de Sèvres, VA, Viroflay, Chaville (p5/18) dont l'exploitant sera le Sigeif, avec un forage à 1500m de profondeur sur la commune de Chaville, pour un coût estimé à 123MEur. Une délégation de service public devrait être votée en 2026. L'alimentation des premiers foyers est prévue en 2029 (p17/32), et le réseau de se développer autour de l'axe de la route D910.
Compte tenu du fait que le concessionnaire du réseau de Chaville est déjà Engie, il est probable que la société sera à nouveau choisie pour l'extension du réseau Chavillois déjà alimenté en 2025 majoritairement par une chaufferie fonctionnant au gaz.
On voit que l'investissement pour ce réseau est important, ce qui s'explique par le fait que l'amortissement d'un RC ne se fait que sur une durée au moins de 25 ans (28).
Le réseau de chaleur de Velizy, qui a été raccordé à la géothermie depuis 2021 alimente 12.000 logements (29), et son examen permet d'évaluer en partie le projet de Gpso.
Cout estimé du projet Gpso
Le cout du forage et de la chaufferie pour le RC de velizy s'est élevé à 25 millions d'Euros. Le RC était en effet déjà construit pour ce projet. Le cout au km du réseau lui même pouvant être évalué à [1;1,5] M/km, celui du projet Gpso, dont la longueur est évalué à 45 km (p17/32), serait dans l'intervalle [45, 65] MEur.
S'il alimente 10.000 logements, le coût de la chaufferie et du forage ne devrait pas être supérieur à celui de Velizy, qui s'est élevé à 25 Millions. Au total, une première estimation donnerait plutôt un cout de 90 (=65+25)ME, plutôt que les 123 ME, annoncés.
Engagement du PCAET
Il est prévu que le réseau produise par géothermie d'ici 2030, 164Gwh/an de production additionnelle (p17/38). Or en 2021, le réseau de Velizy a produit 115Gwh de chaleur (p6/39). Si 60% (p5) seulement est alimenté par géothermie, la production annuelle par géothermie du réseau de Velizy est environ de 115*0,60=69Gwh, c'est à dire pour 12000 logements, 69/164=42% de l'objectif fixé dans le PCAET. Il faudrait en réalité un objectif d'alimenter probablement 12000/0,42=~28000 logements. Or les 3 villes, du Gpso, concernées par le projet (Sèvres, VA, Chaville) ne représentent que 23000 logements. L'objectif du Pcaet ne pourra donc être tenu par cet unique projet. Le projet de Boulogne Billancourt (30) devrait délivrer 0,35*100=35Gwh/an de chaleur par géothermie(31). Le projet de RC Meudon-la-Forêt prévoir de fournir d'ici 2027, 97Gwh (31a), alimenté à 83% par la géothermie avec la mise en chantier de deux puits (31b). Ce dernier réseau représenterait donc une production de géothermie de 0,83*97=80Gwh. La chaleur produite par géothermie représenterait donc d'ici 2030: 80+35+69=184Gwh/an c'est à dire au delà même des 164Gwh annoncés dans le plan de 2022, à l'horizon 2030.
Le réseau de Sèvres/Ville d'Avray/Chaville/Viroflay vise toutefois à l'horizon 2050 un l'objectif inférieur à celui de la neutralité carbone défini dans le PCaet, puisqu'il ne prévoir d'alimenter que 10000 sur les 31000 logements de ces quatre communes. En effet, alors que la part des maisons individuelles ne dépasse pas 15% dans la commune de Ville-d'Avray (31c), si on extrapole cette proportion pour l'ensemble des 4 communes, on peut évaluer à 0,85*31.000=~26000 le nombre de logements en copropriété dans les communes de ce projet de RC.
Financement du projet Gpso
Le financement du réseau de chaleur de Vélizy-Villacoublay, appelé Véligéo, a été réalisé grâce à un partenariat public-privé (Engie concessionnaire) et des subventions.
En particulier sur le 25 Millions du projet (32): 3M ont été apportés par la région, 6M par l'Adme, 5M par la ville et le reste par Engie.
Il est probable pour le réseau de chaleur de Sèvres, VA, Chaville, Viroflay, qu'un financement suivant un schéma semblable sera mis en place, avec une éventuelle intervention de la Banque des Territoires (33), et peut-être une part plus faible venant des communes (34).